Karim Kal

Retranscription écrite de l’entretien public entre Karim Kal et Etienne Hatt
Dans le cadre du colloque Émancipez-vous, organisé par le Musée d’art contemporain de Lyon et le Lycée du Parc
Lyon, le 16 mars 2019
Etienne Hatt : C’est dans l’histoire critique et autocritique de la photographie documentaire que tu t’inscris d’emblée avec les Images d’Alger. Prises au début des années 2000, lumineuses, sereines, elles contrastent avec l’imaginaire de la « décennie noire » qui précède. Peux-tu revenir sur ce travail fondateur ?
Karim Kal : Dans ce premier projet, l’épure, le mutisme, le minimalisme, me sont apparus comme les réponses adéquates à l’abondance d’images dramatisantes de l’Algérie de l’époque. Fortement confronté aux images de presse, j’ai eu une expérience différente en 1997, lorsque je me suis rendu en Algérie. En effet, le drame, bien réel, ne représentait pas la norme, mais la limite jusqu’à laquelle les Algériens tentaient de vivre normalement, avec dignité, courage et pudeur. Cette expérience m’a guidé pour la composition. Aussi l’ouverture des Algériens sur le reste du monde m’a frappé. Cinq ans plus tard, j’avais les images en tête. Il s’agit de 4 vues d’Alger réalisées depuis le quartier populaire de Bab el Oued. Dans la partie supérieure, une vue de la mer soulignée par un liseré de la côte bâtie de Saint Eugène, ainsi qu’une vue de la rade et des navires en attente de déchargement, formant une sorte de blocus commercial. Dans la partie basse, deux photographies réalisées à « 3 Horloges », en plein cœur de Bab El Oued. Les deux ruelles se dirigent vers la mer, offrent par leur limite un recadrage de la ligne d’horizon. Un an plus tôt, elles ont châtié les eaux des inondations qui ont fait plus de mille morts dans le quartier. Lorsqu’on a montré Images d’Alger, en 2003 au Rectangle, avec le directeur du centre d’art, on a décidé de les présenter sous forme de piles d’affiches, dont chaque visiteur pourrait prendre un exemplaire, un dispositif de diffusion archaïque, de la main à la main, en opposition aux représentations médiatiques de l’Algérie de l’époque.

Près de 20 ans après, tu prépares un livre à paraître aux Éditions Loco qui présentera une série en cours de vues depuis des fenêtres de cités populaires ou d’hôpitaux. Le bleu de la mer a cédé la place au noir de la nuit, le lointain au proche. Tu utilises, en effet, depuis le début des années 2010 un mode opératoire récurrent : la prise de vue nocturne avec un temps de pose très rapide et un flash de faible portée qui n’éclaire que les premiers plans. Pourquoi avoir adopté ce protocole ?
Ce protocole s’est imposé petit à petit. Je travaillais dans des territoires où la question de la sécurité est centrale. En investissant ces espaces de nuit, j’en questionne la mythologie. Le flash m’a servi d’outil d’interprétation. J’ai d’abord, à partir de 2011, animé les logements sociaux, et ainsi désigné l’architecture, le bâti, comme le protagoniste principal des dynamiques de relégation. Par la suite, le flash couplé à une vitesse d’obturation rapide m’a permis de m’affranchir des éclairages urbains, de montrer et de faire disparaître les éléments que je choisissais. À la fin du processus, l’espace obscur de l’image en est devenu le signifiant principal.

Ton travail alterne entre la description d’espaces normalisateurs et coercitifs et d’espaces de liberté qui échappent à l’utilitarisme, comme des terrains vagues, ou au contrôle, comme des passages entre les immeubles. Peux-tu revenir sur cette dialectique au cœur de ton travail et de notre discussion sur la normalisation et l’émancipation ?
En me concentrant sur les mécaniques de relégation, de normalisation, de coercition, je suis poussé par un désir de justice sociale, et une aspiration à une certaine liberté. Cette dialectique est apparue clairement dans une image de 2012 : Adam St Priest. À la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, je constate qu’une grande majorité des détenus est constituée de jeunes issus de l’immigration et vivant dans des quartiers populaires de la région lyonnaise. Or, ce graffiti gravé sur une porte de la cellule des greffes, revendication par un dénommé Adam de son passage, me montre que cette appartenance a été intégrée par certains comme élément structurant de leur identité, comme élément culturel. On se construit avec ce qui semble détruire.
Par la suite, cette dialectique est devenue constitutive de mes compositions. L’espace obscur à investir par le regard, part non discursive de l’image, est accolé aux outils de régulation, aux éléments du paysage urbain.

Ton travail se nourrit de références, à l’histoire de la pensée et à l’histoire de l’art. La première, à Michel Foucault, est assez attendue. Quelle lecture en fais-tu ? Comment une pensée peut-elle irriguer un travail photographique ?
Je suis venu à Foucault par de premières lectures liées au post-colonialisme. Frantz Fanon, Césaire, Glissant… m’ont naturellement amené à la lecture de Foucault, de Baudrillard et à leur perception de la nature profondément autoritaire de nos démocraties occidentales. Cette grille de lecture m’accompagne lorsque je me confronte à un territoire, une institution. Ensuite, je cherche à m’ouvrir aux spécificités de l’objet à représenter.
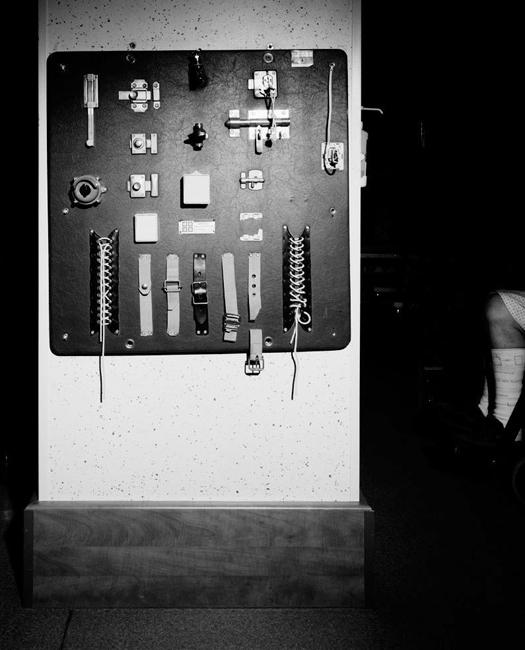
Une deuxième référence, à la peinture abstraite, est plus inattendue. Pourquoi convoquer l’abstraction dans tes aplats ? Comment ne pas tomber dans le piège du formalisme ? Comment faire rimer abstraction avec émancipation ?
Je m’intéresse particulièrement à deux types d’abstraction. L’abstraction géométrique de ces peintres et sculpteurs qui ont relevé la géométrisation de nos sociétés pour en pointer la nature profondément normalisante : Peter Halley, Olivier Mosset..., qui eux-mêmes s’appuyaient sur les théories des philosophes post-structuralistes. Lorsque je suis sur le terrain, j’établis des correspondances formelles entre ces points de repère de l’histoire de l’art renvoyant à des positions politiques très affirmées et les structures sociales telles que je les perçois.
J’intègre aussi l’articulation des expressionnistes abstraits qui, dans leurs œuvres, déterminent des espaces projectifs non discursifs qui impliquent fortement le regardeur. C’est, pour moi, une manière de déjouer, du moins de discuter les mécanismes de normalisation.

L’Algérie fait l’objet de plusieurs travaux (Images d’Alger, 2002 ; Cités d’urgence, Alger, 2006 ; Stations, 2006-2007 ; Environs d’Alger, 2014-2015). Les séries traduisent l’évolution de ton approche et de ton style. Ton regard sur l’Algérie a-t-il aussi changé ?
Mon regard sur l’Algérie évolue au même rythme que mon regard sur les sociétés européennes. Je ne dissocie pas mon travail des deux côtés de la Méditerranée. (L’exemple de la migration est clair, c’est bien l’histoire commune qui se joue.) Parfois, je conçois les images algériennes comme des contrepoints : les infrastructures plus faibles, les dynamiques de normalisation moins abouties laissent une plus grande part au hasard, aux accidents, et se traduisent dans les images par une force poétique accentuée.

Dans les années 2000, ton travail était descriptif. Il mettait le spectateur à distance du réel qu’il donnait à voir dans toute sa clarté. La plupart des travaux incluaient des figures humaines. Aujourd’hui, ces dernières ont disparu et, par la proximité et l’absence de profondeur, tu sembles inviter les spectateurs à prendre leur place dans l’image.
Que signifie ce passage d’un documentaire descriptif à un documentaire qu’on pourrait qualifier d’inclusif ? Qu’en attends-tu ?
J’ai évacué la notion d’exemplarité des histoires spécifiques, individuelles, qui opérait dans mes portraits, par exemple dans Les Miroirs de 2009. J'étais gêné par leur potentiel illustratif, trop réducteur pour les protagonistes.
La dimension projective, au moyen du mutisme des images, induit une implication plus grande du regardeur dans l’objet représenté, et tente de casser la mise à distance qu’opère traditionnellement l’image documentaire avec son point de vue auto-centré, et les systèmes de subordination du sujet à l’auteur qu’il implique. Le réel représenté est envisagé comme émetteur poétique, producteur de sens politique, et non plus comme un objet d’étude.
